Accès direct, orientation, soins relationnels : les grands absents du nouveau décret infirmier
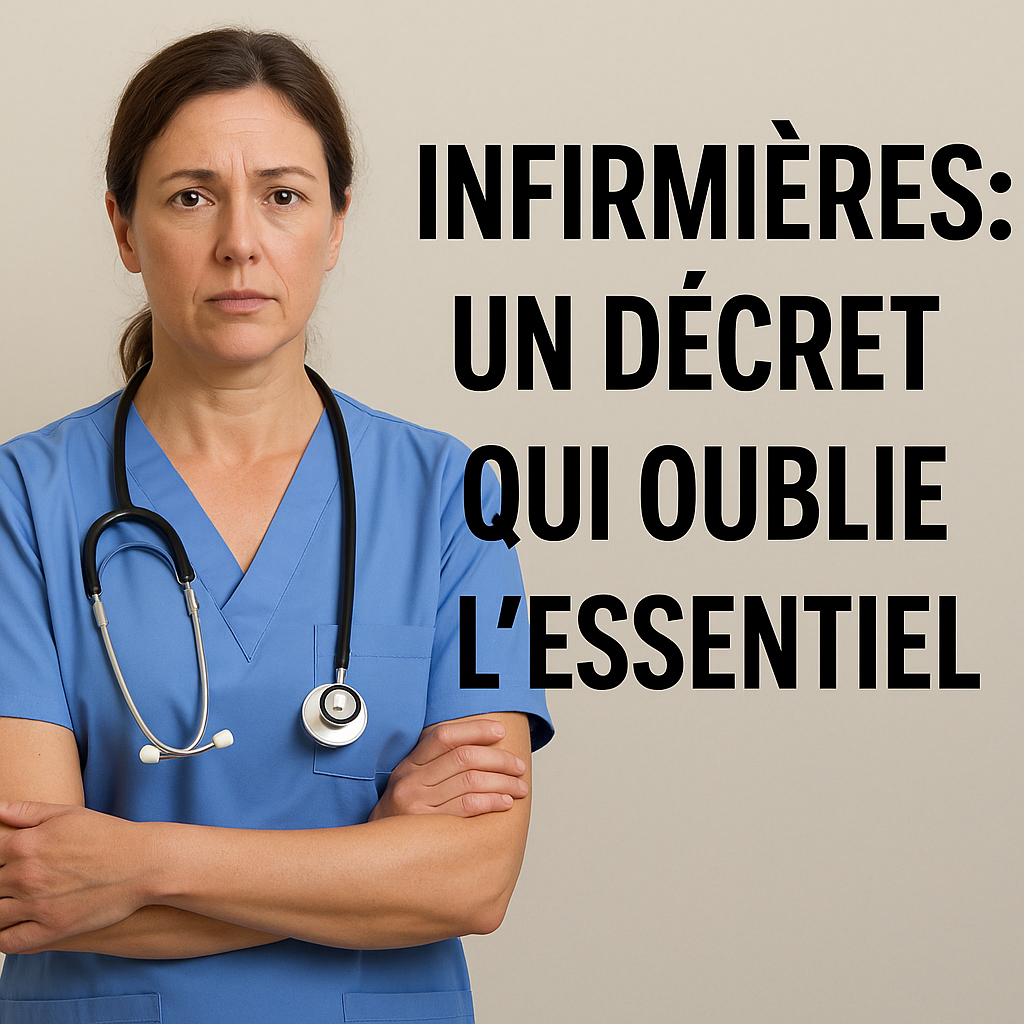
12 septembre 2025
Le décret relatif aux activités et compétences de la profession infirmière est en préparation. Il doit traduire dans le Code de la santé publique la loi votée en juin 2025 sur la profession infirmière. C’est un texte technique, destiné à préciser les actes, les compétences, les rôles. Mais derrière les détails juridiques se joue un enjeu beaucoup plus large : comment la France veut-elle reconnaître et utiliser les infirmières pour répondre à la crise d’accès aux soins ?
Le projet transmis fin septembre par le ministère de la Santé mérite une lecture attentive. Il contient des avancées. Mais aussi des silences inquiétants, et même des reculs par rapport aux intentions affichées lors du débat parlementaire.
La technicité, mais pas la vision
Le texte décrit de manière détaillée l’activité infirmière : analyse, réalisation, organisation et évaluation des soins. Il introduit la traçabilité, le suivi des parcours de santé, et définit pour la première fois la consultation infirmière comme une démarche clinique structurée. Autant de points qui modernisent le décret vieux de vingt ans.
Mais cette technicité se fait au détriment de la vision. Les débats parlementaires avaient insisté sur deux leviers majeurs : l’accès direct aux infirmières et leur rôle d’orientation dans le système de soins. Ces éléments ne figurent pas dans le projet de décret. Le risque est simple : réduire la réforme à une mise à jour formelle, sans impact concret pour les patients.
L’accès direct, un droit oublié
Aujourd’hui, beaucoup de patients se heurtent à une barrière : il faut une prescription médicale pour voir une infirmière. Or, dans les faits, ce sont souvent elles qui assurent la première ligne : surveillance d’un diabète, suivi d’une plaie, accompagnement d’un parent dépendant. Pendant les débats parlementaires, plusieurs députés et sénateurs avaient insisté sur l’importance d’ouvrir la porte de l’accès direct.
Le projet de décret en reste muet. La consultation infirmière est définie, mais rien n’indique qu’un patient puisse s’y rendre sans passer par un médecin. C’est comme construire une maison sans porte d’entrée. On peut multiplier les belles pièces, elles restent inaccessibles. alerte Thierry AMOUROUX, le Porte-parole du Syndicat National des Professionnels Infirmiers SNPI.
Orienter, mais sans le dire
Autre silence préoccupant : l’orientation. Dans un système de santé devenu un véritable labyrinthe, les infirmières sont souvent celles qui tiennent le fil d’Ariane. Elles connaissent les patients, les familles, les réseaux locaux. Elles savent où adresser, qui appeler, comment débloquer une situation.
Le projet de décret se contente de parler de « coordination » et de « planification ». Des mots techniques, administratifs. Rien sur la capacité explicite d’orienter les personnes vers la bonne ressource. Comme si ce rôle, pourtant central dans la réalité du terrain, ne pouvait être assumé officiellement.
Les soins relationnels, invisibles
Lors du vote de la loi, un amendement adopté par l’Assemblée Nationale avait été rejeté par le Sénat : celui de définir les soins relationnels dans la loi. Le gouvernement avait alors promis : ce sera fait dans le décret. Mais là encore, l’engagement n’est pas tenu.
"Le texte mentionne bien que les soins peuvent être « relationnels ». Mais sans jamais les décrire, ni leur donner de contenu. Or, ce sont ces soins qui construisent l’alliance thérapeutique. Ce sont eux qui permettent à une personne atteinte de cancer de supporter une chimiothérapie. Ce sont eux qui aident un malade d’Alzheimer à retrouver un moment de sérénité. Ce sont eux qui donnent du sens au soin. Les invisibiliser dans le décret, c’est nier ce qui fait la spécificité du métier infirmier." alerte Thierry AMOUROUX.
Une prescription réduite au minimum
Le projet reconnaît aux infirmières un droit de prescription, comme le prévoit la loi. Mais il restreint ce droit aux seuls produits et examens « dans le domaine des soins infirmiers ». Une formule vague, et surtout restrictive.
La loi avait prévu une dérogation large à l’exercice illégal de la médecine, précisément pour permettre aux infirmières de prescrire dans le champ nécessaire aux soins. Le décret revient en arrière. C’est comme confier un trousseau de clés et en retirer les plus utiles. dénonce le SNPI.
Une délégation sans base légale
Le point le plus problématique est ailleurs. Le projet de décret en Conseil d’Etat introduit une nouveauté : la possibilité de déléguer certains actes infirmiers aux aides-soignants, aux auxiliaires de puériculture ou aux accompagnants éducatifs et sociaux. Or, la loi du 27 juin 2025 n’a jamais évoqué cette délégation.
C’est donc une création purement réglementaire, sans base légale. Et une dérive dangereuse. Car les soins infirmiers ne se réduisent pas à des gestes techniques. Ils englobent la surveillance clinique, l’évaluation permanente de l’état du patient, les soins relationnels. Déléguer ces tâches, c’est prendre le risque de banaliser des actes qui nécessitent un jugement clinique. C’est aussi exposer le texte à un contentieux pour excès de pouvoir.
L’affirmation du rôle autonome infirmier ne peut être concrète que si l’on protège ses compétences-clés : raisonnement clinique, évaluation, éducation, coordination, prescription. Cela implique de préserver la frontière entre ce qui peut être confié à une aide-soignante, et ce qui relève intrinsèquement de la compétence infirmière.
En conclusion, la différenciation entre infirmière et aide-soignante n’est ni corporatiste ni arbitraire : elle découle directement du niveau de formation, de la responsabilité engagée, et de la nature des compétences requises. C’est au contraire un gage de sécurité pour les patients, de clarté pour les équipes, et de reconnaissance pour chaque métier.
Le rôle propre infirmier ne peut être délégué qu’à la marge, sur des actes simples et stabilisés. Il repose sur un socle de compétences, de responsabilités et de réflexions cliniques que la formation aide-soignante ne prépare pas à assumer. Toute tentative de dilution de cette frontière serait un recul pour la qualité et la sécurité des soins. Valoriser l’aide-soignante, c’est reconnaître son rôle spécifique, pas lui confier ce pour quoi elle n’est ni formée, ni protégée.
Les urgences, un risque de recul
Le projet de décret détaille le rôle des infirmières en situation d’urgence : protocoles signés par un médecin, puis actes conservatoires. En apparence, rien de choquant. Mais le diable est dans les détails. La logique du texte semble enfermer les infirmières dans des procédures protocolisées, là où la pratique avait reconnu leur droit à agir de plein droit face à une urgence.
Dans une maison de retraite, dans un village isolé, aux urgences saturées, ce sont souvent elles qui doivent prendre la première décision. Les enfermer dans des protocoles, c’est réduire leur capacité d’initiative, et donc mettre en danger les patients.
Le fil rouge : un recul par rapport au Parlement
Le constat est clair. Ce projet de décret reprend une partie de la loi. Mais il efface plusieurs avancées obtenues au Parlement :
– L’accès direct des patients, absent.
– Le rôle d’orientation, dilué.
– Les soins relationnels, invisibles.
– La prescription, restreinte.
– La délégation, introduite sans base légale.
C’est une manière de neutraliser l’élan législatif, en revenant au texte initial préparé par l’administration avant les débats.
Une réforme n’a de valeur que si elle change la vie réelle des patients et des soignants. Reconnaître l’accès direct aux infirmières, c’est offrir une réponse immédiate à des millions de personnes qui n’ont plus de médecin traitant. Reconnaître le rôle d’orientation, c’est fluidifier des parcours devenus inextricables. Reconnaître les soins relationnels, c’est valoriser la dimension humaine du soin, celle qui donne du sens et de l’efficacité.
À l’inverse, introduire une délégation sans base légale, c’est fragiliser la profession et exposer les patients à des ruptures de sécurité.
La confiance entre soignants et patients, mais aussi entre professionnels de santé et pouvoirs publics, se construit sur la cohérence. Le Parlement a voté une loi. Le décret doit la respecter. En tentant de rogner certains acquis, l’administration envoie un mauvais signal.
Le système de santé français est à un carrefour. Il peut continuer à s’enfermer dans des logiques hiérarchiques et médicalo-centrées. Ou il peut s’appuyer pleinement sur les compétences infirmières, reconnues et valorisées, pour garantir l’accès aux soins.
Ce projet de décret peut encore évoluer. La concertation est ouverte. Aux infirmières, aux syndicats, aux associations de patients, aux élus, de se mobiliser pour rappeler l’essentiel : l’infirmière n’est pas une exécutante, mais une professionnelle de santé autonome, capable d’initier, d’orienter, d’accompagner, de prescrire. Refuser cette réalité, c’est refuser de soigner la France d’aujourd’hui.
Pour sa part, le SNPI a formulé plusieurs amendements correctifs, pour que le décret reste dans l’esprit de la loi.
***********************************
Les textes réglementaires attendus :
*** En cours de concertation : le présent décret en Conseil d’État, pour préciser les domaines d’activités et de compétences des infirmiers.
*** Au point mort :
• Un arrêté du ministre chargé de la santé pour fixer, dans chacun des domaines d’activités, la liste des actes et soins réalisés par les infirmiers.
• Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour établir la liste des produits de santé et des examens complémentaires que pourront prescrire les infirmiers.
• Un décret en Conseil d’État pour préciser les conditions de la consultation infirmière.
• Des décrets en Conseil d’État pour préciser les modalités de la pratique avancée dans chaque spécialité (IADE, IBODE, IPDE).
• Un décret en Conseil d’État pour préciser l’application de l’article concernant la spécialité autonome des infirmières scolaires.
*** Déjà réalisé :
– le décret du 4 septembre 2025 sur le rôle et les missions des infirmiers coordinateurs IDEC en EHPAD
https://syndicat-infirmier.com/Infirmiers-coordinateurs-en-EHPAD-decret-IDEC.html
– l’arrêté du 5 septembre 2025 qui fixe la liste des diplômes et certificats permettant aux infirmiers anesthésistes d’exercer en pratique avancée.
https://syndicat-infirmier.com/Reconnaissance-IADE-en-pratique-avancee-arrete-du-05-09-25.html
********************************************
Voir également :
– Le SNPI qui a eu connaissance du projet de décret relatif aux activités et compétences de la profession infirmière actuellement en préparation, note que ce texte contient des avancées mais aussi des silences inquiétants, et même des reculs par rapport aux intentions affichées lors du débat parlementaire.
https://www.santementale.fr/2025/09/decret-infirmier-des-oublis-essentiels/
– La réforme infirmière, portée par la loi du 27 juin 2025, visait à donner un cadre inédit aux missions et à l’autonomie de la profession. Pourtant, le projet de décret d’application en cours de concertation est perçu par le SNPI comme un texte qui réduit la portée de cette avancée et risque d’en limiter l’impact. Le syndicat pointe trois omissions majeures : l’absence d’accès direct clair pour les patients, une définition imprécise des soins relationnels et une restriction du droit de prescription, en retrait par rapport à la loi.
https://www.caducee.net/actualite-medicale/16647/le-projet-de-decret-n-applique-pas-la-loi-infirmiere-il-la-corrige.html
– Décret infirmier : le SNPI alerte sur la dénaturation de la loi et saisit les parlementaires https://toute-la.veille-acteurs-sante.fr/236328/decret-infirmier-le-snpi-alerte-sur-la-denaturation-de-la-loi-et-saisit-les-parlementaires-communique/
**********************
Et vous, qu’en pensez-vous ? Partagez votre point de vue. Echangez avec nous sur
twitter https://x.com/infirmierSNPI/status/1830605997188231643
facebook https://www.facebook.com/syndicat.infirmier/
linkedin https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7236362308703191041/
**********************
Nos articles vous plaisent ?
Seul, vous ne pouvez rien.
Ensemble, nous pouvons nous faire entendre ! Rejoignez nous !
https://www.syndicat-infirmier.com/Comment-adherer.html
**********************